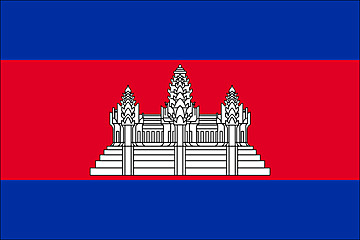MESSAGE À SIPAR
A la suite de notre article « La bibliothèque Mark Twain de Long Beach cherche à acquérir des livres en langue cambodgienne » nous avons reçu le message suivant de Sipar, présidé par Hoc Sothik. Nous le publions ci-dessous en entier.
From: siparpp
To: khemarajati@sympatico.ca
Sent: Thursday, January 10, 2008 3:38 AM
Subject: Fw: Tr : Mark Twain : Cambodge aux livres
Bonjour,
Nous avons reçu votre message par intermédiaire d'un réseau d'amis.
Le SIPAR a un grand plaisir de vous proposer ci-joint un catalogue des ouvrages édités en langue khmère et une plaquette résumant ses missions dans le cadre du développement de la lecture au Cambodge.
Pour nous contacter :
SIPAR
9 rue 21, Tonle Bassac, Chamcarmon- Phnom Penh
Tél : 023 212 407.
E-mail : siparpp@online.com.khSite web: www.sipar.org
Cordialement.
Hok Sothik,
directeur du Sipar.
Pièces attachés : Plaquettes SIPAR Fr07 et Catalogues SIPAR Nov07.Nous publions un écrit très intéressant de Claude Lévi-Strauss « Conservation, contrainte et culture » à la suite de notre présent message à Sipar. Dans cet écrit Claude Lévi-Strauss, un grand ethnologue bien connu, nous livre ses observations sur les manières pour pérenniser une culture, une écriture, face à l’invasion des grandes cultures. C’est un article très instructif pour nous Cambodgiens, confrontés à l’invasion d’autres cultures très puissantes, dont celles de nos voisins.
I / Situation géopolitique actuelle du CambodgeLe Cambodge se trouve au centre du Sud-Est Asiatique, région très importante, au centre des conflits des intérêts géostratégiques des grandes puissances, principalement : Etats-Unis, Chine, Japon, France et maintenant Inde. Le Cambodge est bordé à l’Est et à l’Ouest par deux voisins qui ont pu acquérir des connaissances occidentales très tôt parce qu’ils possèdent des ports pour accueillir les premiers européens dès le début du XVIè siècle. Ce qui n’est pas malheureusement le cas pour le Cambodge. Le premier port de mer n’a été mis en service que depuis 1969. En plus le pouvoir colonial a tout fait pour vietnamiser la Cochinchine, puis progressivement le Cambodge. Comment ? Louis Malleret (lire
http://khemara-jati.blogspot.com/2007/11/cambodge-situation-prsente-et-son.html), le découvreur de Oc Eo grâce aux indications des Cambodgiens de la région, a laissé un exposé très important, montrant comment la France favorise les Vietnamiens aux dépends des Cambodgiens par une discrimination en faveur de l’enseignement de la langue vietnamienne. Malleret, dans son exposé montre comment cette discrimination a permis aux Vietnamiens de chasser légalement les Cambodgiens de Cochinchine de leurs terres ancestrales. Nous reviendrons plus longuement sur cette question dans d’autres articles.
II / Situation sociale, financière et culturelle des Cambodgiens.Actuellement le Cambodge est en train de connaître une grande mutation. Pour la première fois, dans notre histoire, les femmes cambodgiennes jouent un rôle de plus en plus important au point de vue sociale et économique. Les femmes sont pragmatiques. Elles sont obligées de penser à l’avenir de leurs enfants avant de passer leur temps à se lamenter sur le passé. C’est justement ce que dit Raymond Aron dans sa thèse :
« On confond souvent le sens historique avec le culte de la tradition ou le goût du passé. En vérité, pour l’individu comme pour les collectivités, l’avenir est la catégorie première. Le vieillard qui n’a plus que les souvenirs est aussi étranger à l’histoire que l’enfant absorbé dans un présent sans mémoire. Pour se connaître soi-même comme pour connaître l’évolution collective, l’acte décisif est celui qui transcende le réel, qui rend à ce qui n’est plus une sorte de réalité en lui donnant une suite et un but. »Raymond Aron
Dans « Introduction à la philosophie de l’histoire »,
Ed. Gallimard, 1er Ed. Paris 1938. Ed. citée 1986, page 432
Elles sont souvent chefs de familles et se lancent dans le commerce. Pour la première fois dans notre histoire plus d’un demi million d’ouvriers, principalement des femmes travaillent dans des usines. Notons que ces usines n’utilisent, pour le moment que la force musculaire. Ces ouvrières travaillent en dehors du foyer familial. Elles acquièrent ainsi une grande autonomie. En plus avec leurs salaires, elles contribuent à aider et à entretenir leur famille à la campagne. Notons aussi que les ouvrières économisent plus que les ouvriers. Elles ne fument pas et dépensent moins en gadgets. Les salaires des ouvriers représentent quelques 300 à 400 millions de $US. Plusieurs centaines de millions de $US sont d’autre part, apportés par des Cambodgiens vivant à l’étranger pour leurs familles au Cambodge et un peu moins, en ce qui concerne les salaires des Cambodgiens travaillant dans des ONG. En tout cela fait un milliard de $US qui vont directement dans les poches des Cambodgiens du Cambodge. Cet argent contribue dans une proportion notable au développement économique du Cambodge. Notons aussi que de nombreux jeunes Cambodgiens sortant des Grandes Ecoles et des Grandes Universités d’Europe et de l’Amérique du Nord et d’autres ingénieurs et professeurs d’université de haut niveau, à la retraite ont créé des ONG ou des écoles pour former des techniciens de niveau baccalauréat + 2 ans, en particulier en informatique pour fournir le personnel technique des industries de niveau plus élevé que les usines textiles actuelles.
D’autre part, en se rendant régulièrement chez elles, à la campagne, les ouvrières contribuent à diffuser les informations et les connaissances acquises en ville. En même temps elles ouvrent des perspectives pour les filles vivant à la campagne. Ainsi, malgré les mauvaises routes, elles rendent la campagne moins isolée des villes et ainsi du monde extérieur. Une grande partie d’entre elles vont tout faire pour que leurs enfants s’instruisent. L’émancipation des femmes au Cambodge est donc en marche. Le développement d’un pays et la lutte contre les maladies comme le Sida par exemple, passe par l’éducation et l’émancipation des femmes. Il faut aussi noter que le Cambodge est traditionnellement un pays matriarcal.
Pour consolider ces acquis, il faudrait d’abord garantir la stabilité de la propriété privée foncière plus particulièrement celle de la terre et en la rendant inaliénable pendant un certain temps, durant vingt ans par exemple. Naturellement avec un bon service du cadastre. Puis stabiliser la famille par une bonne administration de l’état civil qui enregistre rigoureusement les naissances, les mariages et les décès.
Enfin pour consolider toutes ces acquisitions, pour les amplifier et enfin pour les pérenniser dans l’avenir in faut instruire l’ensemble du peuple et non une poignée d’intellectuels. Il faut donc un bon système d’enseignement :
a/. Scolariser tous les enfants, en particulier les filles, jusqu’au lycée, ayant comme langue véhicule la langue nationale, base fondamentale de la cohésion nationale.
b/. Avoir un bon programme pour rendre nos enfants fiers de leur pays et de leur passé tout en les préparant aux domaines scientifiques nécessaires au monde d’aujourd’hui.
c/. Utiliser progressivement la langue nationale dans les universités comme dans tous les pays de notre région, en particulier chez nos deux grands voisins. Naturellement avec une ou deux langues étrangères. Il est possible maintenant d’utiliser la langue cambodgienne dans les universités de Droit et de Médecine. Nous avons tout ce qu’il faut pour cela. Il manque seulement une volonté politique. Pour les autres disciplines il suffit d’un petit effort pour utiliser notre langue.
d/. Créer un véritable Institut d’histoire, d’archéologie et de géographie, les autres bases de notre cohésion nationale.
III / De l’importance fondamentale de la langue nationale dans le monde.
On situe souvent le commencement de la Nation France au moment où François 1er décide d’utiliser la langue française dans l’administration par son ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Maintenant la langue française est une des bases fondamentales de l’unité de la France. Il suffit de voir l’importance de la Francophonie dans la politique culturelle de la France. Nous allons voir un peu plus loin comment la France peu défendre la Francophonie autrement au Cambodge.
Une autre base de notre unité nationale est l’Histoire, notre Histoire placée dans le contexte de l’histoire du monde, la seule compréhensible. D’autre part, il faut écrire notre histoire en tenant compte de l’économie, des techniques, et des recherches archéologiques. C’est ce qu’avait essayé de faire Bernard Philippe Groslier, malheureusement décédé à 60 ans en 1986. Il avait le projet d’écrire une Histoire du Cambodge depuis la préhistoire. Il est probable qu’il y a des documents concernant ce projet dans ses archives, malheureusement très difficiles d’accès.
« Dès qu’elle prend conscience d’elle-même, une nation veut justifier son présent par son passé. Rien ne lui prouve mieux son existence que son histoire. En ce sens, ce sont les historiens qui créent les nations. »Colette Beaune : « Naissance de la Nation France »
Éd. Gallimard, Paris 1985, p. 9-10.
Naturellement, il est important que les jeunes Cambodgiens se sentent une vocation pour l’histoire. Pour cela il faut commencer par apprendre son métier d’historien avant de se lancer dans l’histoire du Cambodge. Après il faut connaître l’histoire du monde, avant d’aborder l’Histoire du Cambodge. Nous le dirons un peu plus tard les raisons en analysant certains livres d’histoire du Cambodge écrits par des étrangers.
Beaucoup d’intellectuels cambodgiens sont à la retraite. A 60 ans, de nos jours, on est plein de vitalité. Pourquoi ne pas utiliser ses loisirs à lire et méditer sur les problèmes de l’histoire et sur l’histoire du monde, aussi bien en anglais qu’en français. Puis lire les livres sur l’Histoire du Cambodge, surtout les livres des auteurs rarement ou jamais évoqués dans les livres d’Histoire du Cambodge, écrits par des étrangers.
Revenons à notre langue. Nous citons quelques exemples pour montrer comment des étrangers aiment la culture, la littérature et la langue française au point de devenir membre de l’Académie Française. Citons d’abord le cas de François Cheng. Voici ce qu’il a écrit dans son livre « Le Dit de Tanyi » :
« Les œuvres de Romain Roland et de Gide, Jean Christophe, la vie de Beethoven, la Symphonie Pastorale…avaient aiguisé chez nous, l’envie d’entendre la musique classique occidentale. Si la littérature et la peinture nous étaient plus ou moins accessibles par la traduction et la reproduction, la musique nous demeurait quasiment inconnue, à part celle glanée par-ci par-là au hasard de films américains ou de vieux disques. »« Le Dit de Tianyi » par François Cheng, de l’Académie Française,
Ed. Albin Michel, Paris 1998. En format poche, page 97. Les connaissances de l’Occident par les Chinois dans les années 1930.
Œuvres de François Cheng :
· « L’Ecriture poétique chinoise », Ed. Du Seuil, Paris 1977, 1996.
· « Vide et Plein, le Langage Pictural Chinois », Ed. du Seuil, Paris 1979, 1991
· « Cinq Méditations sur la Beauté » Ed. Albin Michel, Paris 2006
· « L’Eternité n’est pas de trop », Ed. Albin Michel, Paris 2002
etc.
François Cheng a donc connu la littérature française, d’abord par des traductions. Il faut remarquer aussi que Cheng est un érudit de la culture chinoise comme le montre des livres sur la calligraphie, la peinture et la culture chinoise. Ce que résume dans un texte que nous publions un peu plus loin de Claude Lévi-strauss :
« Une culture constituée au cours des siècles ne peut plus évoluer ni même se remettre en cause, du fait qu’on ne sait plus ce qu’elle est. »
et un peu plus loin :
« Car on ne peut décider ou l’on ira si l’on ne sait d’abord d’où l’on vient. »
et plus loin :
« Il y a là des leçons dont nous pouvons profiter. L’entreprise à laquelle l’Unesco appelait les participants à la Conférence mondiale sur les politiques culturelles est, elle aussi, une création : création des conditions les plus favorables à la création elle-même. Le danger serait de croire qu’il s’agit seulement de renverser des barrières, de libérer une spontanéité qui, dès lors qu’elle ne serait plus entravée, prodiguerait intarissablement ses richesses : comme si, pour créer, il ne fallait pas d’abord apprendre ; comme si, enfin, le problème qui se pose aux sociétés contemporaines n’était pas pour les unes de retrouver, pour les autres de protéger un enracinement fait de traditions et de disciplines qui, négatives et méprisables au regard du seul esprit de système, expriment le fait qu’on ne crée jamais qu’à partir de quelque chose qu’il faut connaître à fond et dont on doit d’abord se rendre maître, serait-ce pour pouvoir ensuite s’y opposer et le dépasser. »Un autre exemple vient de la Chinoise Dai Sijie qui a écrit le roman, dont le titre montre qu’elle a lu Balzac d’abord dans une traduction chinoise :
« Balzac et la petite tailleuse chinoise » de Dai Sijie, Ed. Gallimard Paris 2000. Ce roman est après adapté au cinéma. Après elle a écrit : « Le Complexe de Di », Ed. Gallimard, Paris 2003.
Rappelons qu’avant 1920, au moins les livres ci-dessous étaient déjà traduits en chinois :
· Thomas Huxley : « Evolution and Ethics » (traduit en 1898)
· Adam Smith : « The Wealth of Nation » (traduit en 1901)
· John Stuart Mill : « A System of Logic » (traduit en 1902)
« On Liberty » (traduit en 1903)
· Herbert Spencer : « Principles of Sociology »
· Montesquieu : « De l’Esprit des Lois » (traduit en 1906)
· E. Jenks : « History of Politics »
· W. S. Jevons : « Logics »
Dans « Histoire du Parti Communiste Chinois, 1, des origines à la République Soviétique Chinoise », par J. Guillermaz, Ed. Petite Bibliothèque Payot, Paris 1975, page 31.
Dans « Mao » de Philip Short, Ed. Owl Books, 1999, Mao Tse Toung (26 décembre 1893 – 9 sept.1976) a lu et discuté avec ses professeurs et camarades de classes les contenus de ces livres, des livres marxistes et des écrits marxistes par des auteurs chinois.
En ce qui concerne les mathématiques, les premières traductions datent du XVIè siècle :
Dans « Une Histoire des Mathématiques Chinoises » par Kiyosi Yabuuti, traduit du japonais par Kaoru Baba et Catherine Jami, Ed. Belin-Pour la Science, Paris 2000, pages 123 – 124 :
« En 1498 le navigateur portugais Vasco de Gamma doubla le Cap de Bonne-Espérance et atteint Calicut en Inde, six ans après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb : c’était la onzième année du règne de l’empereur Hongzhi des Ming. Au début du XVIè siècle les Portugais sillonnaient la Mer de Chine méridionale depuis Goa, et firent de Macao leur base pour le commerce avec la Chine et le Japon. Ce fut la première entrée des Européens en Chine (par la mer, avant, il y avait peut-être un ou des envoyés d’Antonin le Pieux au IIè siècle dont on a trouvé des pièces de monnaie à son effigie au port du Fou Nan à Oc Eo. Ils utilisaient des boutres arabes jusqu’en Inde, puis des jonques chinoises qui faisaient escale à Oc Eo).« Parmi les nombreux missionnaires montés à bord des navires portugais, les jésuites avaient une réputation de moines-savants. Le jésuite François Xavier arriva au Japon en 1549 ; il retourna de là à Goa, puis fit voile vers la Chine pour l’évangéliser. Il ne put cependant pas y pénétrer, le pays étant fermé. Après lui, Matteo Ricci (en chinois Li Madou) fut le premier, en 1582, à pouvoir entrer en Chine où il parvint à établir une mission. Il apportait dans ses bagages des objets produits par la culture européenne, dont il introduisit aussi les connaissances scientifiques, tout cela afin de gagner le respect des Chinois.
« Dans sa jeunesse ce jésuite italien avait étudié au célèbre Collège Romain, où Clavius, surnommé l’ « Euclide du XVIè siècle », enseignait l’astronomie et les mathématiques – deux matières qui allaient s’avérer fort utile dans sa tâche missionnaire. Grâce à l’observation de l’éclipse de lune, Ricci parvint ainsi à déterminer la longitude de la Chine ; il publia par la suite une mappemonde intitulée carte complète de tous les pays de la terre, et enseigna la théorie de la sphéricité de la Terre. Sa réputation fut ainsi établie auprès des savants chinois. Avec leur aide il traduisit en chinois quelques ouvrages de Clavius, connu en Chine sous le nom de Maître Ding (Comme Clavius en latin, Ding signifie « clou » en chinois).
« A partir de 1601, Ricci est autorisé à s’installer à Pékin et à y créer une mission ; des savants chinois à l’esprit ouvert se rassemblèrent autour de lui. Avec l’aide de Xu Guangqi, haut fonctionnaire, il traduisit les six premiers livres des éléments de géométrie, qui furent publiés en 1607. Jihe, qui figure dans le titre chinois (Jihe yuanben), est la transcription phonétique de géo ; le terme chinois (repris en japonais) désignant la géométrie provient d’ailleurs de cet ouvrage.
« Les traductions furent faites à partir de la version latine avec le commentaire de Clavius des Eléments d’Euclide. Bien que celle-ci comportât quinze livres, seuls les six premiers furent alors traduits à la fin des Quing par Alexander Wylie et Li Shanlan. Comme on l’a vu, la géométrie de type euclidien était totalement absente de la tradition mathématique chinoise ; Sans doute est-ce pour cela que Xu Guangqi lui porta un intérêt particulier. »
Mais c’est le Japon qui est le premier pays asiatique à comprendre l’importance des connaissances et de la culture occidentale et à entreprendre la traduction systématique de tous les écrits et documents importants de la civilisation occidentale. Ce n’est qu’après sa défaite devant les armées japonaises équipées et entraînées à l’occidentale en 1895 et plus particulièrement après l’anéantissement de la flotte russe à la bataille de Tsushima en 1905 que la Chine a compris l’importance de l’acquisition des connaissances occidentales.
Il faut cependant noter qu’en Europe c’est tsar Pierre 1er le Grand (1672 – 1725) qui est le premier russe à comprendre que la Russie a besoin d’acquérir les connaissances de l’Europe Occidentale, par des traductions, pour permettre à la Russie de se mesurer victorieusement contre ses puissants voisins que sont la Suède au Nord, la Pologne à l’Ouest et la Turquie au Sud. C’est lui qui a créé le port de Saint-Pétersbourg et la flotte russe. Son œuvre est poursuivie par ses successeurs en particulier par Catherine II la Grande (1729 – 1796). Les grands noms de la musique et de la littérature russe datent de cette époque. Rappelons la défaite mémorable de la Grande Armée de Napoléon lors de la retraite de Russie dont le nom de Bérézina reste gravé dans la mémoire des Français. Cette défaite napoléonienne est le cadre du roman de Léon Tolstoï (1828 – 1910) « Guerre et Paix » souvent adapté au cinéma. Après Waterloo, les armées russes défilent à Paris. Pierre 1er le Grand et ses successeurs ont acquis de nombreuses et très importantes œuvres d’art occidental, maintenant exposées dans les musées russes, en particulier à Saint-Pétersbourg. De nos jours la Russie, le Japon et la Chine sont parmi les plus grandes puissances du monde.
IV / La situation de la langue nationale au Cambodge.Maintenant, la langue nationale est la langue administrative. C’est un pas très important. Mais nos universités utilisent encore les langues étrangères comme langues véhicules. Car ces universités sont gérées par des puissances étrangères qui naturellement privilégient les langues étrangères. Les étrangers financent les publications des dictionnaires Cambodgien – Anglais et Cambodgien – Français. C’est pour favoriser les traductions des textes et documents cambodgiens en anglais ou en français. Or nous avons besoin de dictionnaire de la langue cambodgienne comme celui de Chuon Nath publié dans les années 1960 et de bons dictionnaires Anglais – Cambodgiens et Français – Cambodgien pour faciliter les traductions des livres anglais et français en cambodgien. Un dictionnaire de la langue cambodgienne vient d’être publié au Cambodge en prenant comme base le dictionnaire de Chuon Nath, et en ajoutant les mots nouveaux utilisés depuis les années 1960.
En ce qui concerne les traductions, il faut signaler les nombreuses traductions faites avant 1975,
· Reatrei nimitt nai vassantarodov (Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare), 1968 par Hang Thun Hak avec la collaboration de Kong Orn.
· Krou pèt bet mukh (Médecin malgré lui de Molière, traduit par Peouv You Leng),
· Cinna de Pierre Corneille, traduit par Vong Phoeung, P. Penh, Librairie Koh Kong, 1967.
· La Petite Fadette (vol. 1) (vol. 2) de George Sand, traduit par Ko Youk Ho, Librairie, Khun Thai Sang, Kraceh, 1968.
· L'avare de Molière, traduit par Chan Mom Phavy sous le titre de Kamnanh kraov domra, P. Penh, Seng Nguon Huot, 1965,
· Ben Hur, traduit par Mitt Sakhon, P. Penh, Librairie Banlii Bejr, 1967.
· Notre Dame de Paris, traduit par Vong Phoeung, P. Penh, ed. Rasmei, 1967.
· Saramani de Roland Meyer traduit par Chan Bophal, P. Penh, 1971, 2 vol.
· Animal Farm de George Orwell, traduit par Pan Sothi sous le titre Kal Nous Pakdekvoat Muoy, P. Penh, 1972.
· « Le Cid » de Corneille avec la collaboration de Im Ponn (1969).
D’autre part les éditions Apsara de Montréal ont publié :
· « Antigone » tragédie de Sophocle, traduit par Putry Toth, Montréal 1995.
· « Ulysse » épopée d’Homère, traduit par Putry Toth, Montréal 1997
· « Krong Phnom Penh » Une histoire politique de la ville de Phnom Penh, par Kèo Bounthoeun, Montréal 1995.
Ces livres sont maintenant réédités à Phnom Penh.
Depuis il y a les traductions des livres et BD : « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry, « Le Horla » de Guy de Maupassant et « Harry Potter » de Kathleen Rowling.
Pourquoi cette extinction des traductions ? Au Cambodge, il y a une guerre féroce entre les langues : française, anglaise et chinoise sans oublier les langues de nos voisins.
Ce mépris de notre langue, pourtant base indispensable de notre cohésion nationale, n’explique-t-il pas en grande partie notre difficulté à nous unir, à parler la même langue dans toutes les couches sociales de notre pays ?
Des étudiants cambodgiens venus faire leur stage en France disent que ce n’est pas facile d’étudier en français, car il faut en même temps passer une grande partie du temps à apprendre le français. Ce n’est pas le cas pour les Vietnamiens. Est-ce une des raisons qui font que l’Hôpital franco-vietnamien de Prey Nokor surclasse de loin l’hôpital franco-cambodgien, sous le nom pourtant de l’illustre savant Calmette ? D’ailleurs ne faut-il pas des professeurs cambodgiens pour expliquer aux étudiants la médecine française ? Pourtant il faut bien utiliser la langue cambodgienne pour soigner les Cambodgiens. Faut-il alors avoir recourt aux interprètes ? Le cas se présente de la même manière en ce qui concerne le droit.
Pourtant le Père François Ponchaud dans son « Compte rendu de mission au Cambodge du 16 au 27 septembre 1990 »
http://khemara-jati.blogspot.com/2007/12/ponchaud-compte-rendu-de-mission-au.html ou
http://groups.google.com/group/khemarajati/browse_thread/thread/83a4c34f10378433/84eb75521d0e4e90?lnk=raot#84eb75521d0e4e90 a conclu :
« Il convient à l’Eglise de se montrer vigilant pour ne pas répéter certaines erreurs du passé, alors qu’à la fin du XIXè siècle et du début du XXè siècle, et dans un autre contexte, l’Eglise s’inspirant des schémas coloniaux, favorisait l’implantation vietnamienne au Cambodge. Cela lui valut d’être considérée par les Cambodgiens comme doublement étrangère, et par ses origines et par ses communautés. L’évangélisation des Khmers en a été, de ce fait, compromises pendant près d’un siècle. »Ponchaud a fait traduire et publier pour la première fois une traduction de la Bible et d’autres livres chrétiens en cambodgien. Pourtant les expériences de François Cheng et de Dai Sijie, montrent que c’est en lisant des livres des auteurs français traduits en chinois qu’ils ont aimé la littérature et la culture française.
Pourquoi ne pas continuer à traduire par exemple « Les Misérables » de Victor Hugo, « Carmen » de P. Mérimée, « La Dame aux Camélias » d’A. Dumas, Balzac etc. ?
Mais pour que la traduction soit facilement accessible aux lecteurs cambodgiens moyens, il est souhaitable qu’elle soit faite par des Cambodgiens. Car de toute façon, une traduction c’est toujours, au mieux une adaptation et au pire une trahison. Car il s’agit de transposer une culture sur une autre.
Avec tous nos remerciements pour les efforts de Sipar pour scolariser les enfants cambodgiens, en particulier les plus démunis et les filles.
Khemara Jati
Montréal, Québec
Annexes :
Ci-dessous un article de Claude Lévi-Strauss sur l'importance des relations entre les cultures et de montrer la complémentarité entre "fidélité à soi", et la nécessité de "l'ouverture aux autres", pourtant souvent forcée. D'autre part, une "ouverture aux autres", sans la volonté de rester "fidèle à soi", n'est-il pas une façon de vivre comme des amnésiques ? Pour un peuple, rester "fidèle à soi" c'est d'abord conserver sa langue parlée et écrite, base indispensable pour développer sa culture, pour son évolution par des échanges avec d' "autres cultures et pour sa pérennité ".
Conservation, contrainte et culture
(Par Claude Lévi-Strauss)
Il est bon de poser des problèmes, mais on se gardera de croire que, du fait qu’on les pose, ils comportent nécessairement une solution. Ceux formulés par les documents préparatoires à la Conférence mondiale sur les politiques culturelles sont réels et graves. On peut, toutefois, se demander si leur énoncé n’enveloppe pas des contradictions situées, semble-t-il, sur deux plans. D’une part, « la fidélité à soi » et « l’ouverture aux autres » sont-elles vraiment conciliables, ou faut-il y reconnaître des termes antinomiques ? D’autre part, n’y a-t-il pas de contradiction à imaginer que l’originalité et le pouvoir créateur, qui, par définition, ont une source interne, peuvent être suscités ou stimulés du dehors ?
Considérons séparément les deux problèmes, avant de constater qu’ils se rejoignent. Sur le premier, il convient d’abord de rappeler quelques points :
1) Aucune société, aucune culture ne peut vivre dans un isolement prolongé sans s’ossifier ou s’étioler, et dans les deux cas dépérir. La comparaison entre l’état de l’Europe et celui de l’Amérique au XIVe siècle le montre bien : d’un côté, une civilisation complexe et enrichie d’apports divers – redécouverte de l’antiquité gréco-romaine, influences venues de l’Islam et de l’Extrême-Orient à la suite des croisades, des invasions tartares, d’expéditions marchandes et de missions diplomatiques; de l’autre, des sociétés, elles aussi produits d’une longue histoire, mais qui ; depuis des dizaines de millénaires, fût-ce à l’échelle d’un continent, avaient vécu en vase clos. D’où, malgré un développement culturel comparable à celui de l’Europe et même à certains égards supérieur, des floraisons fragiles et vite avortées, des carences et des difformités, une organisation sociale et mentale sans souplesse et peu diversifiée, ou l’on peut voir les causes de l’effondrement des civilisations précolombiennes devant une poignée de conquérants.
2) Néanmoins, les contacts et les échanges entre peuples, qu’on doit toujours invoquer pour prendre l’épanouissement des cultures, se produisaient dans le passé de manières intermittente, et sur un rythme ralenti tant par des résistances internes que la médiocrité des communications. Au XVIIe et XVIIIe siècles, où fleurit en Europe une culture cosmopolite, il fallait du temps pour que les grands penseurs ou artistes des différents pays puissent se rencontrer ; même les lettres qu’ils s’adressaient mettaient des semaines ou des mois pour parvenir à leur destinataire. Cette lenteur des communications n’était-elle pas un facteur positif, au même titre que la communication elle-même ? Un équilibre que se réalisait ainsi spontanément entre les deux tendances dont les documents de l’Unesco affirment la nécessité : fidélité à soi, et ouverture aux autres.
3) C’est cet équilibre que rompt aujourd’hui la rapidité des transports et des moyens de communications ; ceux-ci sont même devenus pratiquement instantanés. Il en résulte que chaque culture est submergée par les produits d’autres cultures : traductions en livres de poche, albums de reproductions, expositions temporaires à jet continu, qui énervent et émoussent le goût, minimisent l’effort, brouillent le savoir. On pourrait presque dire que, pour chaque société ou chaque culture, la communication en provenance des autres se fait de façon si massive et si accélérée qu’aucune ne saurait plus créer pour son compte propre ou se renouveler au même rythme. De plus, la maîtrise des moyens de transport et de communication, inégalement répartie entre les cultures, met quelques-unes, intentionnellement ou non, en position favorable pour envahir et dominer les autres.
Cette « hypercommunication » constitue peut-être un caractère pathologique propre aux sociétés contemporaines ; mais c’est aussi un état de fait auquel il serait vain de vouloir s’opposer. Prenons au moins conscience des résultats qu’il entraîne : il transforme de plus en plus les individus en consommateurs plutôt qu’en producteurs de culture ; et paradoxalement, cette culture, qu’ils consomment passivement, devient de moins en moins riche et originale, puisque les cultures étrangères leur arrivent dépouillées de leur authentique fraîcheur, déjà contaminées et métissées parce qu’elles ont reçu des autres et, le plus souvent, de la nôtre. Au lieu qu’entre les cultures existent, comme dans le passé, des écarts distinctifs, des différences de potentiel dont chacune extrayait l’énergie nécessaire à son propre développement, les cultures tendent à devenir étales, du fait qu’entre les unes et les autres se sont déjà produites et se poursuivent toutes sortes d’hybridations.
Prétendre remédier du dehors à cet état de choses, en obtenant des cultures qu’elles s’accordent pour respecter et même goûter l’originalité de chacune, ne ferait que les maintenir sur la même pente. Ce serait méconnaître que, selon la formule de Nietzsche, « une volonté forte pour son propre oui et son propre non » anime tout effort créateur : car la foi en des valeurs propres implique inévitablement une certaine surdité vis-à-vis des valeurs autres, allant même jusqu’à leur rejet. Chaque culture ne peut tirer que d’elle-même la force de persévérer dans son être et de se renouveler selon son génie propre, fût-ce au risque de rester fermée à d’autres. Car si, poursuivait Nietzsche, la capacité d’apprécier une autre culture est une conquête, cette conquête se fait toujours chèrement payer.
On pourrait citer des sociétés contemporaines où les jeunes générations n’ont plus aucun moyen de se faire une simple idée de ce furent, dans leur authenticité, les grandes œuvres, disons théâtrales ou lyriques, de leur passé. De prétendus « créateurs », en réalité produits d’un syncrétisme rudimentaire, ne voient plus dans ces œuvres qu’une matière première qu’ils s’arrogent le droit de modeler à leur fantaisie. Une culture constituée au cours des siècles ne peut plus évoluer ni même se remettre en cause, du fait qu’on ne sait plus ce qu’elle est.
Peut-être le meilleur choix – en tout cas, le moins mauvais – est-il celui fait par le Japon contemporain d’une culture à deux vitesses ou, si l’on préfère, à deux secteurs : l’un, où l’on autorise, encourage même le métissage et l’aventure, et où les romanciers, artistes et musiciens qui écrivent, peignent, sculptent ou composent à l’occidentale ont le champ libre; l’autre, farouchement réservé au maintien de la culture traditionnelle. Ainsi se trouvent préservées – mais pour combien de temps ? – les conditions d’une création sincère : car on ne peut décider où l’on ira si l’on ne sait d’abord d’où l’on vient.
Nous retrouvons ainsi l’autre problème qui offre, lui aussi un aspect paradoxal : toute création suppose une volonté de conservation. Il ne peut exister de création authentique que dans un affrontement à des contraintes que le créateur s’efforce de tourner et de surmonter. Soumis aux règles pointilleuses des anciennes corporations – faites, on le sait, d’interdictions plus encore que de prescriptions – l’apprentissage n’a jamais stérilisé les facultés d’invention. Comme encore, parfois, aujourd’hui dans le système japonais du iemoto, les peintres, les sculpteurs et les artisans de jadis, formés à la rude discipline des ateliers, apportent la preuve éclatante que des métiers, transmis au fil des générations par voie d’autorité, n’exclurent pas, mais soutinrent le génie créateur.
Un programme visant à « promouvoir la créativité des individus » et à « favoriser leur aptitude à découvrir » n’a pas grand-chose à espérer de constructions théoriques. Il a son cadre tout tracé dans des traditions et des contraintes particulières à chaque culture et dont un long usage, hérité du passé, est le mieux propre à stimuler la créativité et à l’entretenir. Créer consiste toujours à lutter contre des résistances : matérielles, intellectuelles, morales, ou bien sociales. Créer suppose d’abord qu’on ait pleinement assimilé un savoir, résumant l’expérience, accumulée au fil des générations, des rapports avec un certain type de matière ou d’objet ; ensuite, que ces résistances continuent d’exister, sinon la prétendue création s’exercerait à vide : elle serait incapable d’acquérir une forme, car celle-ci résulte toujours d’une transaction entre le projet encore vague du créateur et les obstacles qu’il rencontre. Ces obstacles sont ceux qu’opposent à l’artisan et l’artiste les matériaux, les outils, la technique; à l’écrivain, le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe; et à eux tous, l’opinion et les mœurs. Prétendre affranchir le créateur des contraintes inhérentes à toute réalité – et la société en est une – n’aurait pas plus de sens que vouloir libérer le sculpteur des contraintes du bois ou de la pierre, ou l’écrivain des règles de la langue dont dépend qu’il puisse simplement se faire comprendre de ses lecteurs.
Il faudrait aussi préciser la signification qu’on donne au mot « créativité ». Le créateur est-il celui qui, de manière absolue, innove, ou celui qui éprouve de la joie à œuvrer pour son compte, même si ce qu’il fait, d’autres l’ont fait avant ou le font aussi bien que lui ? Les grands novateurs sont, certes, indispensables à la vie et à l’évolution des sociétés, mais, outre que leurs dons pourraient ne pas seulement dépendre de l’éducation qu’ils ont reçus ni, plus généralement, de conditions économiques, sociales et morales sur lesquelles le réformateur peut agir, on doit aussi se demander ce que serait une société qui voudrait faire de chacun de ses membres un novateur en puissance. Une telle société ne pourrait pas progresser ni même se reproduire. Adorant la nouveauté, non pour ses réussites toujours rares, mais pour la nouveauté elle-même, elle ferait bon marché de ses acquis, impatiente qu’elle serait de mettre sans relâche autre chose à la place.
En revanche, si l’on attend plus modestement de chaque individu qu’il trouve une satisfaction intime dans des ouvrages, non pas absolument originaux, mais où il puisse investir son savoir, son adresse, sa personnalité ; si l’on cherche à réintroduire dans les sociétés industrielles, et à préserver dans celles qui ne le sont pas encore, une qualité de travail excluant la routine et permettant à tous de se sentir créateurs, alors on reconnaîtra plus facilement que des sociétés comme celles qu’étudient les ethnologues, qui ont fort peu de goût pour la nouveauté, et dont tout l’idéal est de rester telles qu’elles s’imaginent avoir été créées au commencement des temps, savent néanmoins entretenir chez tous leurs membres un esprit créateur. Chacun ou presque est, en effet, capable de produire par lui-même les objets artisanaux dont il a l’usage, de tenir sa partie dans les chants et les danses, et même – fût-ce avec un talent inégal – de sculpter et de peindre les objets religieux ou cérémoniels, en quoi nous avons appris à reconnaître d’admirables œuvres d’art.
Il y a là des leçons dont nous pouvons profiter. L’entreprise à laquelle l’Unesco appelait les participants à la Conférence mondiale sur les politiques culturelles est, elle aussi, une création : création des conditions les plus favorables à la création elle-même. Le danger serait de croire qu’il s’agit seulement de renverser des barrières, de libérer une spontanéité qui, dès lors qu’elle ne serait plus entravée, prodiguerait intarissablement ses richesses : comme si, pour créer, il ne fallait pas d’abord apprendre; comme si, enfin, le problème qui se pose aux sociétés contemporaines n’était pas pour les unes de retrouver, pour les autres de protéger un enracinement fait de traditions et de disciplines qui, négatives et méprisables au regard du seul esprit de système, expriment le fait qu’on ne crée jamais qu’à partir de quelque chose qu’il faut connaître à fond et dont on doit d’abord se rendre maître, serait-ce pour pouvoir ensuite s’y opposer et le dépasser.
Dans "Culture pour tous et pour tous les temps", Éditions Unesco, Paris 1984, pages 95 à 104.
 Susan Taylor, a librarian at Mark Twain Library in Long Beach, views a photocopy of Anne Frank: The Diary of a Young Girl, translated into Khmer, at the library Monday during the unpacking of 1,105 books she and employee Lyda Thanh purchased on a trip to Cambodia. (Kevin Chang / Press-Telegram)
Susan Taylor, a librarian at Mark Twain Library in Long Beach, views a photocopy of Anne Frank: The Diary of a Young Girl, translated into Khmer, at the library Monday during the unpacking of 1,105 books she and employee Lyda Thanh purchased on a trip to Cambodia. (Kevin Chang / Press-Telegram)