La minorité cambodgienne de Cochinchine
Nouvelles du Cambodge
LA VIETNAMISATION DE LA COCHINCHINE DURANT LA PÉRIODE COLONIALE ET LE CAMBODGE DE NOS JOURS
(La minorité cambodgienne de Cochinchine)
Khemara Jati
Montréal, Québec
Le 2 mars 2006
Extrait de la Conférence de L. Malleret sur "La minorité cambodgienne de Cochinchine" dans Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises, tome XXI 1er semestre 1946.
Si j’ai choisi de vous parler des Cambodgiens de Cochinchine, c’est qu’il m’a paru nécessaire de réagir contre des simplifications qui, ne tenant pas compte des conditions historiques, font également bon marché des droits d’importantes minorités ethniques.
Certes, la Cochinchine est loin de présenter la diversité de peuplement de la Haute Région tonkinoise, des confins laotiens ou des plateaux de l’Indochine centrale, communément désignés sous le nom d’hinterland moï. On relève, cependant, sur le territoire des Bouches du Mékong, l’existence de plusieurs minorités formant des groupes tantôt compacts, tantôt sporadiques, et possédant une culture ou des aspirations qui leur assignent des traits originaux. Si le droit nouveau est de promouvoir dans le monde, le respect de la personnalité des peuples faibles, combien alors le devoir nous apparaîtra grand, d’accorder à ces groupements épars, l’attention que réclame leur isolement moral !
Je ne citerai ici, que pour mémoire, les îlots de populations moï, stieng, ma ou mnong des confins septentrionaux ou orientaux de la Cochinchine, encore que ces communautés, tantôt errantes, tantôt sédentaires, représentent très probablement, des restes d’anciens occupants du sol, ayant dominé numériquement, à une époque reculée, dans tout le Delta. Leur personnalité tend à s’atténuer, au contact de la masse annamite, comme a disparu celle d’un important noyau cham de la région de Tây-ninh. Mais, dans la province de Châu-dôc, on trouve encore, un groupement de remarquable de Malais ou de Chams, demeurés fidèles aux traditions coraniques, dont M. Marcel NER a justement souligné l’importance, dans un article du "Bulletin de l’École Française d’Extrême-Orient".
En dehors de ces groupements régnicoles, il convient de mentionner des populations immigrées, telles que les communautés musulmanes de Saigon et de Cholon, qui possèdent dans ces villes, deux mosquées, ainsi que des colonies hindouistes ou sikhs, dont l’existence culturelle est manifestée par six sanctuaires, dont quatre temples brahmaniques. Un autre groupe important, par le rôle qu’il s’est attribué dans l’activité ont totalement disparu des provinces centrales, telles que My-tho, Bêntre ou Gô-cong, ainsi que des vieilles provinces de l’Est, comme Bà-ria, mais on en compte encore, quelques milliers, dans les provinces de Biên-hoà et de Thu-dâu-môt, dernier vestige oriental de leur ancienne expansion.
Si ces populations ont disparu d’une bonne partie du territoire, le souvenir d’une souveraineté révolue subsiste dans la toponymie locale. Certains noms de lieux ne sont que la déformation pure et simple d’anciens vocables cambodgiens. C’est ainsi que, dans Sa-dec, il est facile de reconnaître Phsar Dek, « le marché du fer », dans Sôc-trang, Srok-Khleang, le « pays des greniers », dans Trà-vinh, Prah Trapeang, le « bassin sacré », dans le Bac-liêu, Pô lœuh, le « haut banian », dans Ca-mau, Tuk Khmau, les « eaux noires », dans My-tho, Mê Sâr, la « dame blanche ».
D’autres sont la traduction annamite d’un ancien toponyme cambodgien. Ainsi, Bêntre, la « berge des bambous », correspond à l’ancien Kompong Russey et, dans Bên-nghe, « la berge des bufflons », ancien nom d’une partie du Saigon, on discerne aisément le vieux Kompon Krabey. Ailleurs, le terme ancien est devenu méconnaissable, mais il a souvent persisté dans l’usage populaire et l’on entend dire Rung Damrey, « l’enclos des éléphants », pour désigner Tây-ninh, Long Hor, le « devin noyé », pour Vinh-long, Meat Chruk, le « groin du porc », pour Châu-dôc, Kramuôn Sâr, la -« cire blanche », pour Rach-gia, Pêam, « l’embouchure », pour Hâ-tiên, et surtout Prei Nokor, du sanskrit nagara, « la Ville de la Forêt », pour désigner Saigon Cholon, c’est-à-dire l’ancienne cité khmère qui occupait semble-t-il, une partie de la Plaine des Tombeaux.
Comme on le voit, ces vocables se rapportant soit à des ressources naturelles, soit à des traits du paysage, sont d’une manière générale, assez expressifs. Ils ont été remplacés, surtout pour désigner les villages, par des termes qui, selon l’usage sino-annamite, énoncent des vœux de prospérité, de bonheur ou de richesse. Notre administration s’est souvent prêtée à ces substitutions, surtout lorsqu’elle a procédé à des regroupements de communes, pour des raisons d’économie ou de commodité. Il est arrivé que de nouveaux noms annamites n’aient eux-mêmes plus de sens, et que les éditions successives des cartes du Service Géographique (1) n’arrivent pas à suivre ces modifications arbitraires de la toponymie. Je connais un village de la province de Rach-gia ou l’ancien nom de Ban thach, signifiant « table de pierre », est devenu Ban tân-Dinh, par fusion des noms des villages de Ban Thach et de Tham-dinh, ce qui ne représente désormais aucune signification. Or, j’avais été attiré vers ce village, par cet ancien nom insolite, et ma visite ne fut pas vaine, puisqu’elle aboutit à reconnaître dans la « table de pierre », non pas un banc de latérite, comme on l’affirmait, mais un important dépôt coquillier, de plusieurs centaines de mètres de long, marquant un ancien rivage, avec deux buttes en coquille meubles, mêlées de tessons de poterie, correspondant à ces amoncellements de débris alimentaires, laissés par des populations primitives, et que les préhistoriens désignent sous le nom de " kjokkenmoddinger ".
Cette digression tend à établir que le Delta de Cochinchine est loin d’être un pays jeune et d’habitat récent, comme d’aucuns ont cru pouvoir l’affirmer, avec l’autorité des demi savants. Vous savez tous, que les recherches archéologiques s’appuient souvent, sur d’infirmes indices, et s’il m’est permis d’émettre ici, un vœu, c’est que non seulement tout ce qui subsiste de l’ancienne toponymie soit recueilli, comme le souhaitait Étienne AYMONIER, il y a quelques soixante ans, mais encore que l’administration soit extrêmement circonspecte, dans l’attribution de dénominations nouvelles à des villages, et s’attache à maintenir, là ou il subsiste, le cachet souvent très significatif, des noms cambodgiens.
Il est possible que les vestiges préhistoriques, auxquels je viens de faire allusion, soient les témoins d’une ancienne expansion de populations indonésienne, aujourd’hui refoulées vers les hauteurs ou les forêts du Nord et de l’Est. Ainsi s’expliqueraient peut-être, ces curieuses survivances de traditions matriarcales, que je signalais, il y a quatre ans, en Cochinchine, qui s’expriment dans des légendes cambodgiennes et que l’on retrouve travesties, dans certains récits annamites. Quoiqu’il en soit de ces populations paléo-khmères ou proto-khmères, il est certain que le Cambodge, dont toute la civilisation ancienne a gravité dans l’orbe de la culture indienne, a englobé la Cochinchine actuelle, et y a maintenu sa souveraineté entière, jusqu’au milieu du XVIIe siècle.
Dès le début de l’ère chrétienne, il y eut en Cochinchine et dans le Sud du Cambodge, un état hindouisé, le Fou-Nan des historiens chinois, dont il m’a été permis de retrouver un certain nombre de sites, dans le Transbassac. Je ne citerai ici, que la ville maritime d’Oc-èo, avec son probable avant-port de Tà Kèo, qui s’étendait au pied de la colline de Bathé, à vingt-cinq kilomètres du rivage actuel du Golfe du Siam. Dans cet immense "emporium" de plus de 400 hectares, se coudoyait, semble-t-il une population cosmopolite, puisque l’on y retrouve confondus, des objets marqués d’influences indonésiennes, indo-môn, indiennes, iraniennes, hellénistiques et mêmes romaines.
L’observation aérienne montre que ces populations avaient acquis la maîtrise de l’eau, par des travaux d’irrigations ou de drainage et le creusement d’immenses canaux, dont on retrouve des traces, jusque dans les terres semi noyées de la Plaine des Joncs. Il y a moins de trente ans, le pays du Transbassac était recouvert d’une immense forêt, et ceux qui ouvrirent les voies de la colonisation moderne purent entretenir la fatuité de croire qu’ils étaient les premiers à défricher des espaces vierges. En réalité, une population dense a vécu autrefois, dans ces territoires semi aquatiques, et une inscription du Ve siècle, provenant du centre même de la Plaine des Joncs, laisse de fortes raisons de penser que cette région, aujourd’hui presque déserte, fut conquise par l’homme, une première fois, « sur la boue ».
Il n’entre pas dans mes intentions de dénombrer ici, toutes les preuves de la continuité du peuplement khmer en Cochinchine, à travers les siècles. Les témoignages découverts, depuis bientôt dix ans, se comptent maintenant par centaines. Ce pays fut couvert de sanctuaires en briques, dont seules les fondations ont généralement subsisté. Il y eut des foyers bouddhiques, ver le VIe siècles et peut-être auparavant dans les provinces de Rach-gia, Trà-vinh, Bên-tre, au Cap St-Jacques et dans la Plaine des Joncs. Les idoles brahmaniques, principalement vishnouites, sont particulièrement nombreuses, et réparties un peu partout. Mais les cultes sivaïtes, confondus peut-être avec ceux de divinités territoriales ou d’emblèmes de la souveraineté politique, sont loin d’être rares, non plus. Des villes s’élevèrent dans le Delta, comme celle de Prei Nokor à Saigon-Cholon, d’Oc-èo dams le Transbassac, des Cent Rues, dans la Plaine des Oiseaux, au Nord de Camau. Au XI siècles, la souveraineté khmère fut particulièrement affirmée, dans la région de Sôc-trang, autour du port de Bassac. Deux siècles plus tard, le témoin d’un établissement hospitalier du grand roi Jayavarman VII, se retrouve près de Can-tho. Enfin les récits des annales cambodgiennes ou annamites, ainsi que les écrits des voyageurs et des missionnaires, attestent que la domination khmère se maintient, avec persistance, tant qu’elle puit s’affirmer à l’abri du bouclier que les Chams opposèrent désespérément à l’expansion annamite.
Le Cambodge qui fut un immense empire, se trouva démantelé dans les derniers siècles, par des rivaux avides de se partager ses dépouilles, le Siam à l’Ouest, et l’Annam à l’Est. Ses frontières politiques sont loin de correspondre, de nos jours, à l’aire d’expansion de ses groupements ethniques. Au Siam, si l’on fait abstraction de cette Alsace-Lorraine, dont la restitution est prochaine, qu’est la région de Battambang-Sisophon, on compte d’importants noyaux de Cambodgiens, sur le plateau de Korat, dans les régions de Buriram, Suren, Khukhan, à Prachinburi et jusqu’aux approches de Bang Kok. Au nombre de 450 000, ils forment, en quelque sorte, le répondant occidental de la minorité de Cochinchine, et sont des vestiges de l’ancienne puissance politiques du Cambodge qui, sous le règne de Jayavarman VII, engloba tout le Siam actuel, y compris une partie de la péninsule malaise, poussa une pointe en Birmanie et dans le Haut Laos, s’étendit sur toute la Cochinchine et, pendant un quart de siècles, se maintint au cœur de l’Annam actuel, dans la région de Binh-dinh.
L’expansion annamite en Cochinchine, commence à se manifester sous une forme officielle en 1658. Depuis le début du siècle, ce peuple imprégné de culture chinoise, avait rapidement progressé sur les côtes d’Annam, au détriment de l’ancien Champa, royaume de culture indienne, dont la résistance était épuisée. En 1602, les Annamites avaient atteint Qui-nhon, puis franchit la Varella. En 1653, ils érigeaient en circonscriptions administratives, les territoires de Nha-trang et de Phan-rang et, avant même de s’être établis fortement à Plan-thiêt, avaient prononcé leurs premiers empiétements dans les régions de Dong-nai et de Moi-xui, c’est-à-dire de Biên-hoà et de Bà-ria.
Je n’entreprendrai pas ici, de relater dans le détail, l’histoire de leur progression dans le Delta du Mékong. Qu’il me soit permis pourtant, de mentionner les principales étapes. En 1698, toute la région du Dong-nai est annexée et divisée en trois circonscriptions, correspondant de nos jours, à celles de Biên-hoà, Gia-dinh et Saigon. En 1715, l’Annam accepte sans vergogne, l’hommage d’un aventurier chinois qui s’était taillé une principauté de fait, dans la région de Hà-tiên. Tout le XVIIIème siècle fut occupé à réunir les possessions de l’Est, à ce territoire occidental. En 1732, les Annamites organisaient à leur profit, la circonscription de Long-Hor, c’est-à-dire Vinh-long, avec les régions côtières, jusqu’à Trà-vinh et au Bassac. En 1735, ils absorbaient la région My-tho, avec tout le pays situé au Nord du Fleuve Antérieur. En 1757, ils poussaient une pointe extrême jusqu’à Châu-dôc, opérant ainsi la soudure, entre leurs acquisitions du Nord, du Sud et de l’Ouest. La rébellion des Tây-son qui, à la fin du XVIIIème siècle, ensanglanta le pays, pendant vingt-cinq ans, ralentit à certains égards, les progrès de cette expansion et à d’autres la consolida. Mais il est remarquable de constater que c’est seulement en 1832, c’est-à-dire trente ans à peine avant l’expédition franco-espagnole de 1859-1860, que l’Empereur Minh-Mang organisa les territoires de Cochinchine en circonscription administratives, d’où sont sorties par remaniements, les provinces actuelles (2).
Les dates que je viens d’énumérer ne marquent que la consécration officielle des empiétements annamites. Ceux-ci furent, à l’origine, le fait d’aventuriers, de vagabonds, d’exilés politiques, de déserteurs et aussi de non-inscrits, c’est-à-dire de gens qui ne possédant plus rien dans leur village, se trouvaient exclus de l’organisation communale et s’en allaient chercher ailleurs, des moyens de subsister. Il y eut ensuite, des populations transportées, principalement du Quang-binh ou du Binh-dinh. Enfin, des colonies militaires, dont l’importance semble avoir été notablement exagérée, contribuèrent à fonder de nouveaux villages, surtout dans les régions du Centre et de l’Ouest.
La fixation des nouveaux venus trouva des conditions particulièrement favorables, dans la période de la guerre des Tây-son, ou le souverain d’Annam dépossédé, trouva refuge en Basse Cochinchine. À la faveur de cette époque de troubles, les Cambodgiens purent conserver une bonne part de l’administration officielle et l’on vit même, l’un d’eux adopter la cause du prince annamite et commander, pour lui, une troupe de partisans. La politique d’annamitisation à outrance, ne commença guère que sous le règne de Minh-Mang, après 1820. On remplaça partout les fonctionnaires cambodgiens par des mandarins annamites et l’on fit pression sur les habitants, pour les contraindre à adopter le costume, la langue et les usages annamites. A Trà-vinh, une sanglante révolte éclata en 1822, dont on n’eut pas aisément raison. C’est alors que s’édifièrent, un peu partout, ces fortins signalisés sur d’anciennes cartes, dont le rôle était de surveiller les populations cambodgiennes. En 1841, une autre rébellion éclata, dirigée par SA SAM, à un moment où l’Annam était en difficulté avec le Siam. Noyée dans le sang, elle fut le signal d’une lourde politique d’oppression et de spoliations. Dès cette époque, des Cambodgien abandonnent le pays pour se réfugier en masse au Cambodge. En 1856, une nouvelle révolte, suivie de deux autres en 1859 et 1860 (3). Il fallut notre arrivée pour que les Khmers de Cochinchine durement traités par les mandarins et les colons annamites, puissent retrouver le sentiment de la liberté et une protection qui empêcha leur éviction totale du territoire du Bas Mékong. Elle leur permit en outre, de conserver une part encore importante de leur patrimoine, déjà fortement entamé par des procédés qui ne s’embarrassaient guère de la précaution du droit.
Les nouveaux venus s’installaient, en effet, sur les territoires du Sud selon leur convenance, et fondaient leurs villages, aux endroits qui répondaient le mieux à leur commodité ou à leurs habitudes. « Les lots de terre étant choisis, écrit un chroniqueur annamite, il suffisait d’en exprimer le désir au mandarin, pour en devenir propriétaire. On ne prenait pas d’avantage note de ce qui était bonne ou de mauvaise nature ». Ce texte définit une méthode d’appropriation, reposant sur de simples occupations de fait, dont le principe s’est survécu dans toutes les infiltrations vers le Transbassac.
Mais, le choix des arrivants allait surtout aux régions basses, situées le long des voies d’eau naturelles, et il suffit de jeter les yeux sur une carte au 25.000°, pour constater de nos jours, dans les provinces de Trà-vinh ou de Sôc-trang, les manifestations de cette préférence. Toutes les agglomérations annamites épousent les sinuosités des "racb", c’est-à-dire des cours d’eau, tandis que les villages cambodgiens se répartissent sur les croupes de sable, que l’on appelle des "giongs" et qui sont probablement, d’anciens cordons littoraux.
Alors que le village annamite concentre ses maisons, parmi des palmiers d’eau, des cocotiers et de maigre aréquiers, le Cambodgien indépendant et fier, préfère l’habitat dispersé, dans un paysage de jardins. Le premier construit sa demeure de plain-pied, sauf dans les régions qui envahissent les débordements de fleuves. Le second accorde sa préférence à l’habitation sur pilotis. Ses maisons s’isolent, parmi des arbres au feuillage touffu, sur des plus salubres ou le sol est plus sec, la fièvre bénigne et l’eau plus saine.
Un regard accoutumé aux traits du paysage cochinchinois, reconnaît de loin, ces agglomérations villageoises, à des lignes continues de verdure, limitant l’horizon, que dominent de place en place, des bouquets d’arbres. C’est parfois, mais rarement, le "borassus" ou palmier à sucre, l’arbre typique des savanes cambodgiennes, parfois le "pring", survivant des forêts-clairières, surtout le "koki", que les Annamites appellent "dau", dont les troncs énormes et droits, se prêtent au creusement des longues pirogues de course, que possède tout village cambodgien.
Les bosquets de "koki" signalent de loin, les pagodes et survivent comme des témoins, lorsque celles-ci ont cédé la place à quelque temple annamite. Dès l’entrée, l’on est saisi par l’ampleur du terrain, au milieu duquel s’élève le sanctuaire, parmi des avenues et des bassins, avec çà et là, des salles de réunion ou des cellules sur pilotis, pour la méditation des bonzes. Ce sentiment de l’espace, des perspectives et de la verdure, associés à l’habitation humaine, marque ces enceintes sacrées, d’un trait qui les distingue des temples annamites et chinois, où les constructions sont presque toujours entassées. L’on se plait alors, à reconnaître, dans cette architecture aérée, le même sens de la distribution des volumes et des lignes dans l’espace, qui dès le premier contact avec Angkor Vat, éveille la notion de l’harmonie et de la grandeur, que possédaient au plus point, les artistes anciens
Ces pagodes de Cochinchine ne se distinguent guère de celles du Cambodge. Elles se ramènent invariablement, à une vaste construction élevée sur un terre-plein, entourée d’une galerie et coiffée de plusieurs toitures emboîtantes, dont les ressauts présentent parfois une grande complexité, et admettent, d’un temple à l’autre, de nombreuses variantes. Sous la corne élégante qui prolonge les angles du faîte, des pignons en bois sculpté, doré ou peint, se rapportent rarement à la légende de Bouddha, mais plutôt à des sujets tirés de l’iconographie brahmanique. Parfois, des motifs d’inspirations chinoise ornent les toitures et ce trait, s’il témoigne des bonnes relations des Khmers avec les Célestes, indique aussi, que nous ne sommes plus au cœur du Cambodge, mais dans une aire de contacts, ou des contaminations artistiques sont plus volontiers tolérées.*
Malheureusement, l’usage du ciment armé a introduit souvent le mauvais goût, dans ces constructions, dont certaines étaient charmantes. De belles boiseries ont cédé la place à d’affreux moulages, et je ne saurais trop insister ici, sur la nécessité d’une rééducation du sens esthétique, que les Khmers eurent au plus haut degré et qui, s’est avili, Pour une nation soucieuse, comme la nôtre, de réveiller et de cultiver les plus belles qualités des peuples de l’Indochine, il n’est pas, je crois, de plus noble tâche. Un effort considérable fut accompli, à Phnom Penn, par les Corporation Cambodgiennes de Georges Groslier. Une véritable renaissance se manifesta dans l’industrie du tissage et l’orfèvrerie. Or, il y eut autrefois, en Cochinchine, dans la région du Triton, des ateliers familiaux où l’on fabriquait des tentures de pagodes d’une grande richesse décorative. Cet art s’est perdu, comme se perd de nos jours, celui des anciens architectes, des sculpteurs, et des enlumineurs. S’il m’est permis d’émettre encore un vœu, c’est que les Cambodgiens de Cochinchine aient bientôt leur école d’art, comme en ont les Annamites, à Biên-hoà, Thu-dâu-môt et Gia-dinh.
L’intérieur de ces pagodes n’a ordinairement rien de remarquable et l’on est frappé, lorsqu’on y pénètre, par la sobriété de l’ameublement et du décor. Il n’y a rien qui rappelle ici, l’encombrement et l’opulence touffue des sanctuaires annamites ou chinois. Quelques nattes sont étendues sur le sol, ou prendront place les bonzes, dans leurs prières. Sur un côté, est posée la chaire du supérieur. Sur l’autel principal, se dresse une grande statue du Bouddha, entourée souvent d’une grande quantité d’autre idoles, de dimensions plus modestes, mais qui ne sont guère que la répétition de l’image principale. Quelques peintures murales relatent des scènes de la vie du Maître, ou de ces naïves histoires que l’on appelle des "jataka", ou des épisodes de Ramayana, ou encore de la légende du Prah Enn, c’est-à-dire Indra, toujours reconnaissable à son visage vert.
Le Bouddhisme de ces Cambodgiens, qu’ils soient de Cochinchine ou du Cambodge, est celui du Petit Véhicule, c’est-à-dire la doctrine tirée du canon pâli et qui domine dans les contrées du Sud, y compris Ceylan, le Siam et la Birmanie. L’enseignement est demeuré très proche de la tradition primitive, le panthéon extrêmement réduit et l’iconographie très pauvre. Mais je dois ajouter que cette forme du bouddhisme est d’importation thaï et n’a pénétré au Cambodge, qu’à une date relativement récente. Dans la période d’Angkor, ce qui dominait, c’était l’autre Bouddhisme, celui du Grand Véhicule, dont les dogmes, s’étaient enrichis d’apports complexes, qui admet un panthéon plus vaste, et devait donner lieu à des manifestations artistiques plus considérables.
On aurait tort, cependant, de croire que la doctrine bouddhique telle que l’enseignement les bonzes à robe jaune, peuvent suffire à satisfaire toute la dévotion des pieux Cambodgiens. Avant de quitter la pagode, dirigeons-nous vers l’angle Nord-est de l’enclos. Nous y trouvons presque toujours, un modeste abri, fait de quelques planches ou d’un lattis de bambou. C’est la résidence du "neak ta", esprit tantôt favorable, tantôt malfaisant, ordinairement représenté par quelques pierres informes devant lesquelles le vent disperse la cendre refroidie des bâtonnets d’encens. C’est une concession des bonzes au culte des génies qui occupe une si grande place, dans l’esprit des paysans, qu’ils soient Cambodgiens ou Annamites. Les Khmers de Cochinchine, comme leurs parents du Cambodge, redoutent la perfidie des puissances invisibles, les "Krut", les "Arak", les "Mémoch", et font volontiers appel à des sorciers, pour apaiser leur courroux. Certains de ces esprits domestiques ou champêtres ne sont que d’anciennes divinités brahmaniques, aujourd’hui déchues. C’est ainsi que la Néang Khmau, la Dame noire, la Bà Dèn des Annamites, qui a donné son nom à la montagne de Tây-ninh, n’est autre que Durga, la terrible Kali, dont le nom se retrouve dans celui de Calcutta, divinité bienfaisante ou cruelle, qui passe pour responsable de tous les maux qui atteignent la frêle existence des enfants.
Toute la campagne est remplie de la présence muette de ces esprits, dont les rustiques autels s’élèvent au détour du chemin, sur des talus de rizières ou au pied de grands arbres. Il faut quotidiennement prendre garde de ne pas exciter leur colère, et j’ai eu souvent, pour mon compte, à tenir avec eux une conduite circonspecte, quelles que fussent du reste, les régions de la Cochinchine, car sous le nom de "ông ta", ils tiennent aussi, une place considérable, dans la dévotion du paysan annamite. Et ceci, me remet en mémoire, deux anecdotes particulièrement significatives du rôle de ces génies.
J’avais entrepris d’enlever, pour le Musée de la Cochinchine, un grand linga en grès, qui pesait bien une demi tonne, et jouissait de la réputation d’être un "neak ta" malfaisant. Cette idole gisait abandonnée dans une dépression humide, où elle était menacée de déprédations. Mais il fallait la transporter jusqu’à un canal, pour l’acheminer vers Saigon par voie d’eau. Il était difficile d’utiliser les charrettes trop légères. Je fis donc appel à un traîneau de rizière, auquel on attela des bœufs. Mais après quelques centaines de mètres, ceux-ci refusèrent obstinément d’avancer. On les remplaça des buffles qui manifestèrent la même mauvaise volonté. Comme le "neak ta" passait pour être particulièrement redoutable, je compris que j’étais perdu de réputation, si je n’avais pas aussitôt raison de cette pierre récalcitrante. Je fis donc faire une claie, à laquelle s’attelèrent vingt hommes, et l’on porta l’idole au village. Mais là, personne ne voulut accueillir, auprès de sa demeure, cet hôte indésirable. Je le fis donc déposer devant la maison commune, ou j’habitais alors, en prescrivant de le placer le long du sentier qui conduisait à l’entrée. On le mit de travers. Je le fis redresser. On le remit de travers. Comme je demandai la raison de ces manœuvres insolites, on m’expliqua que, dans le premier cas, je serai atteint directement, par les manifestations de la mauvaise humeur du génie, tandis que, dans le second je serais préservé, que l’on avait contrevenu à mes ordres, dans l’intérêt de ma personne, mais que si, décidément, je ne tenais pas à être protégé, l’on ne pouvait après tout, que m’abandonner à un funeste sort.
A quelques temps de là, je revins visiter un tertre, ou j’avais entrepris des fouilles. Au sommet de celui-ci et au pied d’un arbre, se trouvait un bloc de gratuit informe, contenant un esprit dont l’animosité était bien connue dans toute la région. J’avais prescrit qu l’on évitât de déplacer cette pierre, précaution indispensable pour conserver des coolies. Ce jour-là, je trouvai sur le tertre, trois hommes occupés à présenter des offrandes au "neak ta". Ils venaient de déposer, devant l’autel rustique, un canard rôti, un flacon d’alcool, quelques fruits, des bâtonnets d’encens et un bol de riz. Comme ils se relevaient et se disposaient à partir, ils m’expliquèrent que leur père étant venu un jour assister à mes travaux, avait été subitement pris d’un malaise, dont il ne se remettait pas, qui était certainement imputable à la malignité de la pierre-génie. A mon tour, j’allais m’en retourner quand un Cambodgien, nommé Thach Vong qui m’accompagnait, me demanda la permission d’adresser une requête à l’idole. Je le vis alors, s’abîmer dans un long conciliabule avec la pierre. Il lui parlait à voix basse, accompagnant ses paroles de gestes persuasifs. Il s’expliquait au "neak ta" que lui, Thach Vong, était pauvre et qu’il avait faim, tandis que l’esprit puissant, entouré de la crainte et de la vénération publiques, était abondamment pourvu. Il lui demandait donc, bien humblement, de le prendre en pitié, et de l’admettre à partager le festin que des hommes généreux venaient d’offrir. J’imagine que l’esprit se laissa aisément convaincre, car Thach Vong ayant bu l’alcool, rompit les pattes et le cou du canard, les laissa en partage au génie et fort dévotement, mit tout le reste sous son bras.
Ces histoires de "neak ta" nous montrent combien ces bons Cambodgiens sont des âmes simples, à l’égal du reste, du plus grand nombre des paysans annamites, qui ne demandent qu’à cultiver leur terre, dans la paix. Les uns et les autres sont également dignes de sympathie et de sollicitude, et lorsqu’on a partagé leur existence modeste, but le thé sur la même natte, prêté une oreille complaisante à leurs propos naïfs, on s’aperçoit alors, qu’ils sont très proches de nous, et que leur accueil ressemble étonnamment, à celui de nos campagnes de France, ou l’on n’oppose pas délibérément, une méfiance hostile à l’étranger.
Que de fois, il m’est arrivé, parcourant à pied, à cheval, en charrette ou en sampan, les provinces de la Cochinchine, d’accepter la franche hospitalité des pagodes cambodgiennes. L’on s’empressait de m’apporter quelques noix de coco, pour étancher ma soif, tandis que j’offrais en retour des bâtonnets d’encens ou un paquet de thé. Dans la maison de repos des hôtes, on étendait une natte et, dans les heures chaudes de la journée, au cœur de la saison sèche, quand l’air est pur et léger, je ne connais pas d’impression plus sereine que celle de s’étendre sur les claies de bambou de ces maisons sur pilotis, tandis que les bonzes en robe safran passent silencieusement dans les cours et qu’un vent espiègle murmure, dans les hautes touffes des cocotiers.
Mais souvent, j’arrivais à une heure où l’école de la pagode bruissait du murmure des jeunes enfants et cela me conduit tout naturellement, à évoquer ici, le problème de l’enseignement qui se pose sous un aspect grave, pour la minorité cambodgienne de Cochinchine. Celle-ci forme un ensemble homogène, par sa langue, sa religion, ses coutumes, ses traditions. Attachée à sauvegarder ses usages, elle répugne à envoyer ses enfants à l’école franco annamite et ne dispose que très rarement, d’école franco khmères.
On a essayé jusqu’ici, de résoudre la difficulté, en favorisant le développement de l’enseignement traditionnel, dans les écoles de pagodes. Celles-ci sont de trois types. Les unes sont indépendantes et, de ce fait, échappent entièrement à notre contrôle. On en comptait 95 en 1944, réunissant 1.538 élèves. D’autres sont subventionnées. Il y en avait 20, au début de 1945, avec 571 élèves. Enfin, depuis quinze ans, l’on s’est attaché à multiplier le nombre d’écoles de pagode dites "rénovées", où l’enseignement est donné par des bonzes, qui on suivi un stage de perfectionnement, à Phnom Penh, à Trà-vinh ou à Sôc-trang et que l’on s’efforce de conseiller, autant que le permet le droit de regard que l’on peut s’attribuer, sur des établissements de caractère presque exclusivement religieux. Le nombre des écoles de ce type a passé de 37, en 1930, à 90 en 1936, et à 209 en 1944, parmi lesquels on comptait 1.093 filles, jusqu’ici traditionnellement écartées du bénéfice de l’instruction. Dans le même temps, le nombre des écoles officielles franco khmères n’a pas dépassé le nombre de 19, avec 30 maîtres seulement.
Il y a là un problème qui doit retenir l’attention. Quel que soit le soin que l’on ait apporté à la formation des bonzes instituteurs, la création des écoles de pagode, fussent-elles "rénovées", n’est qu’un moyen de fortune, qui ne saurait remplacer un enseignement de type normal à deux cycles, l’un élémentaire, où le véhicule de l’enseignement peut demeurer le cambodgien, l’autre complémentaire avec initiation à la connaissance du français. Mais l’on se heurte à la question difficile du recrutement des instituteurs et tous les efforts entrepris, pour la pénétration scolaire, dans les pays cambodgiens, sont paralysés par cette insuffisance numérique et qualitative du personnel. J’avancerai donc encore ici, un vœu en faveur des Cambodgiens de Cochinchine. C’est que le nombre des écoles élémentaires et complémentaires franco-khmères soit rapidement accru, de façon à former des sujets pourvus du certificat d’études, aptes, les uns à devenir instituteurs auxiliaires, les autres à fournir un premier contingent d’élèves-maîtres, dans des Écoles Normales, auxquelles il faudra bien revenir, si l’on entend rompre décidément avec la politique d’enseignement primaire au rabais, qui a été suivi en Indochine, depuis la crise économique de 1929-1933.
Ce problème ne touche pas seulement, à l’obligation d’accorder à l’enfant cambodgien de Cochinchine, le niveau d’instruction primaire auquel il a droit. Il englobe, aussi, la grave question du recrutement d’une élite. Dans la minorité khmère du Bas Mékong, comme du reste dans l’ensemble du Cambodge, le fait qui saisit l’observateur, c’est que cette société est privée, en dehors du clergé, d’une classe véritablement dirigeante. Dans le vieux royaume khmer, ce sont souvent des Annamites qui fournissent le contingent des fonctionnaires de l’administration ou qui occupent les professions libérales, et cette situation, dont les Cambodgiens sont les premiers à s’alarmer, sans beaucoup réagir, semble avoir des origines très lointaines. Il est remarquable, en effet, que la décadence de ce pays ait coïncidé avec l’époque où se produisaient dans l’Inde, les invasions musulmanes. A partir du moment où le Cambodge fut privé de l’encadrement que lui apportait, semble-t-il, des brahmanes, sa déchéance commença (4). Il y a quelques raisons de penser que des causes ayant tari le recrutement d’une élite, produisirent les mêmes effets, dans l’ancien Founan, et l’on a vu les Siamois s’opposer plus récemment, au relèvement de la nation cambodgienne, en massacrant lors de leurs incursions, les classes dirigeantes ou en les emmenant en captivité.
Quoi qu’il en soit, l’œuvre urgente, l’œuvre nécessaire, c’est d’accorder à la minorité cambodgienne de Cochinchine, les moyens de sauvegarder sa personnalité, en créant pour elle, des écoles, et surtout, en rompant avec l’habitude de la portion congrue, qui consistait à donner à des instituteurs cambodgiens communaux, des salaires dérisoires, comme c’était le cas en Cochinchine, en 1943, où des maîtres recrutés à grand peine, recevaient pour pris de leur activité professionnelle, toutes indemnités comprises, vingt et une piastres par mois.
Le problème de la pénétration scolaire, dans cette minorité, n’est pas le seul qui soit digne de requérir notre bonne volonté, mais il est d’une importance capitale, car tous les autres dérivent de l’ignorance où le paysan khmer se trouve de ses droits. Très attaché à sa terre, il n’est pas armé, pour défendre son patrimoine, et devient souvent la victime d’incroyables spoliations. Ses bonzes qui sont ses tuteurs naturels et qui l’ont maintenu dans la voie d’une magnifique élévation morale, demeurent étroitement attachés à la tradition et sans lumières sur les obligations et les rigueurs de l’existence moderne. Les "achars", vieillards respectés que l’on consulte dans les occasions difficiles, ne sont, eux non plus, que de fort braves gens, attachés à la coutume non écrite et dénués de ressources, devant les impitoyables nécessités d’une organisation sociale, où la bonne foi des faibles est exposée à de rudes assauts.
Le contact de deux populations, l’une active et entreprenante, l’autre apathique et traditionaliste, produit quotidiennement des abus, que notre pays ne saurait couvrir de son indifférence, et qui relèvent, semble-t-il, au premier chef, de la mission d’arbitrage fédéral qui lui est dévolue en Indochine. Je connais une agglomération de la province de Long-xuyên, où la fusion du village cambodgien avec un village annamite, mesure décidée sans précaution, par l’autorité administrative, a eu pour résultat de déposséder entièrement le premier de ses terres communales, au profit du second qui était pauvre, en sorte que l’école de celui-ci est devenue florissante, tandis que l’école de celui-là végète désormais, faute de ressources. Je citerai aussi, un hameau cambodgien de la province de Rach-Gia, établi loin des routes et des canaux, dont les habitants connurent un jour, par moi, avec stupeur, qu’ils n’étaient plus propriétaires de leur terrains d’habitation, ceux-ci ayant été incorporés au Domaine public, parce que n’ayant aucun titre régulier ou n’ayant pas été informés du sens des opérations de bornages, ils ne s’étaient pas présentés devant les commissions cadastrales (1).
Faut-il s’étonner si, devant ce qu’ils considèrent comme des mesures arbitraires, les Cambodgiens abandonnent, parfois en masse, certains villages, pour fuir l’injustice et la spoliation. Des créanciers annamites ou chinois font signer à des paysans khmers illettrés, des actes léonins qui aboutissent, à brève échéance, à la dépossession totale du débiteur. Le mal était devenu si manifeste, et l’usure si coutumière de semblables expropriations, que l’administration française du s’en alarmer. En 1937, le visa de l’enregistrement fut déclaré obligatoire pour les billets de dettes, avec signature conjointe du débiteur et du créancier. A Trà-vinh, il apparut même nécessaire, d’exiger leur présence, lors de l’inscription des hypothèques sur les registres fonciers.
Ils serait souhaitable, à un autre égard, que fussent élargies, ou renforcées, certaines mesures prises à la veille de la guerre, par l’autorité française, notamment celles qui prescrivaient que, dans les villages mixtes, l’élément khmer fut représenté par un nombre de notables proportionnel à son importance, ou encore, celle qui instituait un officier auxiliaire d’état civil, dans les villages en majorité cambodgiens. Mais ces mesures ne pourraient devenir pleinement efficaces, que si les notables ainsi désignés, prenaient rang, sous certaines conditions et selon l’importance numérique de la minorité, parmi les plus considérable des membres du conseil communal.
Il est important aussi, que l’élément cambodgien ait la place qui lui revient, dans tous les corps élus, à quelque échelon qu’ils soient institués. On avait proposé, il y a une vingtaine d’années, que des cantons autonomes, relevant directement de l’autorité supérieure, fussent organisés, là où la minorité se présente en formations suffisamment compactés pour justifier cette mesure. Mais on peut concevoir aussi que la désignation de chefs de cantons khmers soit déclarée obligatoire, dans les régions où le groupe ethniques est prépondérant, avec des sous chefs de cantons, là ou il ne détient pas la majorité. De toute manière, il est nécessaire que les Cambodgiens relèvent des fonctionnaires ou des conseillers parlant leur langue et que, dans les concours administratifs, un certain nombre de places soient réservées aux candidats aux fonctions publiques, avec à titre provisoire, des conditions spéciales. Il paraît indispensable que la langue cambodgienne soit officiellement admise dans la rédaction des requêtes ou de la correspondance administrative. Enfin, on ne peut que souhaiter le développement du bureau des affaires cambodgiennes, qui avait été créé à la veille de la guerre, auprès du cabinet du Gouverneur.
Les Cambodgiens sont appelés à prendre une certaines importance numérique en Cochinchine. Loin d’être en recul, leur nombre s’accroît à chaque recensement. En 1888, ils étaient 150.000 sur 1.600.000 habitants. En 1925, ils étaient devenus 300.000. A la veille de la guerre, on en comptait environ 350 000, sur une population globale de moins de cinq millions d’habitants. Leurs relations avec les Chinois sont excellentes, et l’on compte de nombreux métis sino-cambodgiens qui, fait remarquable, adoptent volontiers les coutumes de la mère, ce qui est rarement le cas pour les métis sino-annamites. Les khmers de Cochinchine entretiennent généralement avec les Annamites des relations dénuées de sympathie. Ceux-ci les appellent avec condescendance, des "Thô", c’est-à-dire les "hommes de la terre", mais ils rendent mépris pour mépris, en traitant les autres de "Yun", du sanskrit "yavana", c’est-à-dire des "Barbares du Nord" (5). Il est certain que ces inimitiés, fondées sur des incompatibilités de mœurs, de langue, de religion et aussi, sur toute l’amertume d’anciennes dépossessions, ont pour effet d’entretenir un état de friction latente, préjudiciable à la paix sociale, et qui réclame le contrôle d’un arbitre.
A cet égard, la Cochinchine apparaît par excellence, comme une terre fédérale, où la France pitoyable aux faibles et généreuse envers des sujets loyaux, doit faire prévaloir des solutions de justice et rétablir l’équilibre que tend à détruire dans le monde, la triviale sélection des plus forts. Il lui appartient d’attribuer à la minorité cambodgienne du Bas Mékong, un statut politique qui n’a jamais encore été clairement défini, à sauvegarder ses droits par des mesures administratives, à maintenir son originalité culturelle, à protéger surtout sa fortune immobilière, patrimoine qui s’amenuise un peu tous les jours, par l’effet d’incroyables abus. J’ajoute que notre pays ne saurait se désintéresser non plus, de la condition morale de ces populations. La minorité cambodgienne de Cochinchine s’est traditionnellement appuyée sur le Bouddhisme du Sud, tandis que l’Annam adoptait le Bouddhisme du Nord. Il reste à la France, vieille nation chrétienne et libérale, devenue par l’Afrique, une métropole musulmane, à devenir pour l’Asie du Sud-est, une métropole bouddhique. Ce n’est plus un secret, que le Japon avait tenté d’organiser à sont profit, les sectes du Bouddhisme en Indochine, et que le Siam poursuivait depuis longtemps au Cambodge, les mêmes fins, pour des raisons d’expansion territoriale. Les bonzes cambodgiens de Cochinchine se trouvent placés dans le rayonnement de l’Institut bouddhique de Phnom Penh, ayant aussi des attaches au Laos, institution de caractère fédéral, dont le développement est souhaitable et l’importance ne saurait être sous-estimée.
Je voudrais en terminant, attirer votre attention, sur quelque égards dus à ces populations, quand l’on se trouve appelé à circuler dans leurs villages. Il est bon, quand on pénètre dans une pagode, ou l’on est reçu toujours, dès le seuil, par quelques bonzillons ou quelque moine de seconde importance, de demander à saluer le chef du monastère, qui est souvent un respectable vieillard. Si c’est l’heure du repas ou s’il repose, il est courtois de ne pas insister. Les Cambodgiens sont toujours sensibles aux égards que l’on a pour leur clergé, ou pour les "achars" si l’on a quelque question à traiter qui intéresse la pagode. L’on vous offrira du thé ou de l’eau de coco. Acceptez-les, même si la tasse est crasseuse ou même si vous n’avez pas soif, car ce don émane toujours d’un cœur ouvert. Asseyez-vous sur la natte, où le supérieur vous convie. On fera, autour de vous, un cercle respectueux. Enquerrez-vous des besoins locaux, de l’état des récoltes, de la santé du bétail, de la fréquentation des enfants à l’école de la pagode. Ne manquez pas de faire une visite au bonze-instituteur. Distribuez des bonbons ou des images. Ayez un propos aimable pour les vieillards. Soyez jovial à l’occasion. J’ai pu obtenir des renseignement qui m’ont conduit à d’importantes trouvailles archéologiques, simplement en distribuant des boîtes d’allumettes, des bâtonnets d’encens, ou des morceaux de savon, en soignant de petites plaies, ou encore, en versant quelques gouttes de collyre, dans des yeux d’enfants atteints de conjonctivite. Ne soyez jamais impatients, ni trop pressés, et n’offrez jamais d’argent à des bonzes. La règle leur interdit de l’accepter. Si vous êtes cependant dans la nécessité de le faire, usez de l’intermédiaire d’un laïc, "achar" ou autre, en spécifiant toujours, qu’il s’agit d’une contribution de votre part ou de l’administration, à l’entretien du sanctuaire ou au développement de l’école.
Si vous devez séjourner dans la pagode ou y établir un cantonnement, prescrivez à vos hommes de ne pas être trop bruyants, surtout au moment des offices. Même si le terrain est très vaste, faites établir hors de l’enceinte, les constructions provisoires qui devront répondre aux besoins de la vie matérielle. Veillez surtout à ce qu’aucun animal, bœuf, porc ou même poulet, ne soit sacrifié dans cet enclos, où la vie animale est sacrée, à l’égal de l’existence humaine. Ces quelques précautions suffisent ordinairement à s’assurer la sympathie de populations qui ne demandent qu’à être fidèles. Beaucoup de ces remarques sont valables, dans les pays annamites, et il faut bien peu de manifestations de bienveillance, pour réussir la conquête des cœurs.
Par leur remarquable tenue morale, les Cambodgiens de Cochinchine on gagné notre estime et mérité la sollicitude que la communauté française se doit de témoigner à ceux qui, ayant souffert dans leur personnalité nationale, ont compris que l’avenir de leur pays ne pouvait se concevoir que dans un ensemble assez vaste, pour apaiser des frictions et faire éclore de communes aspirations. Si j’avais accepté ce soir, de vous entretenir de cette minorité, si digne d’être préservée d’une assimilation inéluctable, c’est sans doute qu’il m’a plu d’être ici, l’avocat des faibles. C’est aussi parce que la Cochinchine est un pays chargé d’histoire, où il est juste que survivent les descendants authentiques des bâtisseurs d’Angkor. Et puis, qu’il me soit permis de plaider aussi, la cause de ceux qui pensent que l’universalisme ne suffit pas à tout. Ce qui faisait pour le voyageur et l’artiste, la séduction et la variété du monde, est en train de s’abîmer dans une effroyable uniformité d’habitudes. Il semble que sous la terrible contrainte des lois industrielles, il n’y ait plus de place pour la charmante originalité des coutumes, où les peuples manifestaient leur génie. Mais la France est une vieille nation d’équilibre et de raison. Sa pensée mûrie par des siècles de réflexion claire, dispose d’un clavier riche de nuances et de demi-tons, où s’exprime toute la complexité de la nature humaine. Aux conceptions simplistes et confuses des tard-venus dans la voie de la civilisation, elle ne cessera d’opposer avec sang-froid, la notion de la diversité du réel. Il lui appartient, dans un monde nouveau, de promouvoir un esprit nouveau, fondé non plus sur des simplifications égalitaires, mais sur des considérations de justice proportionnelle et sur le droit de toutes les nations à l’existence, double espoir dans lequel il nous plaît de reconnaître et de saluer une revendication d’humanité.
Louis MALLERET.
Conférence d'information, faite à Saigon, le 17 décembre 1945, sous le patronage du Bureau des Affaires Culturelles du Service Fédéral de l'Instruction Publique, pour les officiers et fonctionnaires du Corps Expéditionnaire de l'Indochine. Publiée dans "Bulletin de la Société des Études Indochinoises", Tome XXI, 1er Semestre 1946.
Notes.
(1) Dans les Services Géographiques de l'Indochine, et aussi dans tous les services techniques de l'Indochine, même au Cambodge, la totalité du personnel non français est à cent pour cent annamite.
(2) Les Portugais s'installent à Malacca en 1511. A partir de cette année, on ne peut plus comprendre l'histoire de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie de l'Est sans tenir compte de ce changement de caractère géostratégique. Car l'Europe exporte ses connaissances, son système d'organisation administrative, ses armes et son organisation militaire etc. Les peuples au contact avec eux sont donc avantagés par rapport aux autres. Jean-Michel Sallmann vient de publier "Géopolitique du XVIè siècle, 1490 - 1618", Ed. Points-Histoire-Seuil, Paris 2003.
"Au début du XVIè siècle, les Portugais avaient commencé à fréquenter les côtes du Sud (du Dai-Viet ou Annam). Au début du VIIè siècle les Hollandais, installés à Batavia depuis 1619, venaient, eux aussi, commercer à Faifo le grand port au Sud (de l'Annam). Quelques années plus tard, les Anglais les y suivirent. Quand aux Français, ils n'apparurent qu'à la fin du XVIIè siècle, et leur commerce connut sa période la plus florissante dans la première moitié du XVIIIè siècle. Au début du XVIIè siècle, débarquèrent également les premiers missionnaires jésuites (qui étaient alors surtout portugais et italiens) : le Genevois Buzoni et le Portugais Carvalho en 1615. Dans les années 1620-1630, le jésuite français Alexandre de Rhodes organisa véritablement la mission du Tonkin." (Dans "Le Million", volume VIII, page 110, Ed. Grange Batelière, Paris 1972.)
Alexandre de Rhodes invente la romanisation de la langue vietnamienne en 1650. Mais cette romanisation ne sera commencée à être utilisée systématiquement que par le pouvoir colonial. Cette romanisation est essentielle pour permettre aux Vietnamiens de sortir de la domination culturelle chinoise. Elle est maintenant adoptée par tous les vietnamiens. Benedict Anderson, un universitaire Américain a écrit un livre très intéressant intitulé "Imagined communities" (Editions Verso, Londres 1983, 1991) et traduit en français sous le titre "L'imaginaire national" (Editions La Découverte/Poche, Paris 1996, 2002), édition française de 2002, pages 130, 131, 132)
"Alors même que les dynasties de Hanoi et de Hué défendaient depuis des siècles leur indépendance à l'égard de Pékin, elles (la Chine et la civilisation chinoise) régnaient à travers un système mandarinal délibérément calqué sur celui des Chinois. La bureaucratie recrutait en soumettant les postulants à des examens écrits sur les classiques confucéens ; les documents dynastiques étaient rédigés en caractères chinois ; et la culture de la classe dirigeante était fortement sinisée. A partir de 1895, ces liens anciens prirent un tour encore plus indésirable, lorsque les écrits de réformateurs chinois comme Kang Yu-wei et Liang Chi-chao, mais aussi de nationalistes comme Sun Yat-sen, se répandirent à travers la frontière septentrionale de la colonie. En conséquence, les examens confucéens furent successivement abolis au "Tonkin" en 1915, puis en "Annam" en 1918. Dès lors, le recrutement dans la fonction publique en Indochine devait se faire exclusivement par un système de formation colonial en plein essor. De surcroît, le quôc ngû, écriture phonétique romanisée conçue par des missionnaires jésuites au XVIIè siècle et adoptée dès les années 1860 pour la "Cochinchine", fut délibérément encouragé afin de rompre les liens avec la Chine - et peut-être aussi avec le passé indigène, en rendant les chroniques dynastiques et les littératures anciennes inaccessibles à une nouvelle génération de Vietnamiens colonisés. (en note : La plupart "des fonctionnaires coloniaux de la fin du XIXè siècle […] étaient convaincus qu'un succès colonial durable passait par un combat acharné contre les influences chinoises, y compris le système d'écriture. Les missionnaires voyaient souvent dans les lettrés confucéens le principal obstacle à la conversion générale du Viêt-nam au catholicisme. Dans leur esprit, éliminer la langue chinoise, c'était donc simultanément isoler le Viêt-nam de son héritage et neutraliser l'élite traditionnelle" (Marr David G., "Vietnamese Tradition on trial, 1920-1945", University of California Press, Berkeley et Los Angeles, 1981, p. 145). Kelly cite en ce sens un auteur colonial : "En fait, l'enseignement du seul quôc ngû […] aura pour effet de rendre accessibles aux Vietnamiens les seuls ouvrages de littérature et de philosophie que nous souhaitons leur faire connaître. C'est-à-dire ceux que nous jugeons utiles pour eux et aisément assimilables : uniquement les textes que nous transcrivons en quôc ngû (Kelly Gail, "Franco-Vietnamese Schools, 1918 to 1938", thèse de doctorat, University of Wisconsin, 1975, p. 22)
Durant les années 1770 et 1780, la révolte des frères Tay Son se rend maître du Vietnam. Le prince Nguyen Anh qui a échappé aux Tay Son se réfugie à Bangkok. 1787, Le fils de Nguyen Anh, le prince Nguyen Anh, âgé de 7 ans, accompagné de Monseigneur Pigneau de Behaine, arrive à la cour de Versailles et est reçu par Louis XVI. Nguyen Anh avec les aides en armes et en matière de stratégie et d'organisation militaires de Mgr Pigneau de Behaine et d'une poignée de soldats et d'officiers français, réussit à vaincre les Tay Son et à reprendre Huê la capitale du royaume en 1802. Il se fait couronner sous le nom de Gia Long. En 1804, la Chine reconnaît Gia Long comme son vassal et donne pour la première fois le nom de Vietnam au lieu de Nan-Viet à son voisin du Sud. Mais ce nom ne sera utilisé définitivement par les Vietnamiens eux-mêmes qu'après la Deuxième Guerre Mondiale.
La poignée de Français qui ont aidé Gia Long à vaincre les Tay Son, ont appris aux Vietnamiens la construction des Forteresses à la Vauban, dont celui de Huê.
C'est cette armée vietnamienne armée et entraînée à la française qui venait occuper le Cambodge sous le règne de la reine Ang Mei.
(3) "Bien qu'il soit indiqué que le canal de Prêk Chik constituait la limite de l'expansion viêt pour la partie occidentale (de la Cochinchine), il est difficile de savoir si chacun de ses deux tronçons formait ou non la ligne frontalière. Il est malgré tout vraisemblable - puisque Peam Sdei (Tradeu), située sur la rive gauche du Fleuve Antérieur, demeura cambodgienne jusqu'au règne de Narottam (d'après une lettre du gouverneur de Cochinchine du 6 novembre 1865) - que la ligne frontalière suivait le canal de Prêk Chik depuis Peam jusqu'à Moat Chrouk, puis de ce poste frontière jusqu'à Peam Sdei avant de s'enfoncer selon un tracé indéterminé dans la Plaine des Joncs. Il faut cependant observer que ce canal, malgré le blocus des Vietnamiens - qui prétendaient tout simplement être les intermédiaires des Khmers avec les nations étrangères, et avaient de ce fait interdit son accès aux jonques de commerce cambodgiennes - continuait à être franchi par les Khmers habitant tant sur la rive septentrionale que sur la rive méridionale, et qui se refusaient à le considérer comme une frontière.
"En 1858, alors que les Français étaient est train d'opérer en pays vietnamien, le gouverneur de la partie khmère de Peam (Hatien), l'Ukana Raja Setthi nommé Kaep, alla reprendre, sur ordre du roi Hariraks Rama (Ang Tuon), la province de Treang Troey Thbaung (viet. Tinh-Bien), et aussi attaquer les provinces de Bassac, de Preah Trapeang, de Kramuon Sar et de Moat Chrouk. Après l'accession au pouvoir en 1860 du roi Narottam - le Norodom des ouvrages européens - les chroniques royales khmères notent que ce monarque fit de ce même gouverneur son ministre de la guerre et lui confia de nouveau le commandement des troupes opérant au sud du canal Prêk Chik. Dans une note rédigée par Doudart de Lagrée, celui-ci indique que le gouverneur Kaep, à la suite d'hostilités entre Khmers et Vietnamiens au sujet des Cam et des Malais, poursuit les Vietnamiens, Cam et Malais jusque dans Treang Troey Thbaung, s'y maintint, et envoya régulièrement le tribut à la cour d'Oudong "sans objection de la part desAnnamites", et cela jusqu'à l'arrivée des Français -(d'après A. B. de Villemereuil, 1883, les opérations de Kaep ont certainement un rapport avec les insurrections khmères dirigées par les adjoints de l'ancien gouverneur de Bassac nommé Lim, qui tentèrent en 1859 de secouer à nouveau le joug vietnamien et qui mirent en déroute en 1860 les troupes vietnamiennes. D'autres insurrections khmères se produisirent par la suite sans interruption jusqu'à l'installation des Français dans cette province, celle-ci étant faite d'ailleurs avec la participation active des Cambodgiens. A cette époque, les Français remplacèrent partout les chefs et les sous-chefs de canton par des fonctionnaires cambodgiens. Dans Monographie de la province de Soc-trang, 1904, p. 66-67 et A. Forest "Le Cambodge et la colonisation française" Ed. L'Hamattan, Paris 1980, p. 434) - , ce qui revient à dire que depuis les événements de 1858, les Cambodgiens étaient redevenus maîtres d'une partie de leurs anciens territoires situés au sud du canal Prêk Chik, notamment de cette province de Treang Troey Thbaung qui, partant de la partie centrale du Canal Prêk Chik et englobant la région de Svay Tong (Triton), s'étendait au moins jusqu'au Phnom Thom (Viet. Nui Sap) au pied duquel coule le canal de Kramuon Sar."
Dans "La frontière entre le Cambodge et le Vietnam du XVIIè siècle à l'instauration du protectorat français, présentée à travers les chroniques royales khmères" par Mak Phoeun, article dans "Les frontières du Vietnam", sous la direction de P. B. Lafont, Ed. L'Harmattan, Paris 1989.
(4) Malleret, ici, se réfère aux thèses de Georges Coedes. C'est normal à cette époque. Bernard-Philippe Groslier a fait des recherches plus approfondies et a eu des documents que ne connaissaient pas Coedes. Nous reproduisons ci-dessous un texte de B.-P. Groslier :
"Quoi qu'il en fût, les origines de ce commerce, certainement antérieure à la Rome impériale, restent incertaines. Rien en réalité ne permet d'affirmer qu'il s'est établi d'ouest en est. Les textes chinois, nombreux et précis, sont clairs. Dès les Han antérieurs, soit au IIè siècle avant J.-C., les Chinois trafiquaient dans les mers du Sud. La preuve archéologique en est donnée par les nombreuses céramiques Han retrouvées à Java, antérieures de quatre siècles aux premiers vestiges indiens. Les relations de la Chine furent naturellement actives avec les pays frontaliers comme la Birmanie et le Vietnam, au point de conduire en 111 avant J.-C. à la conquête du Nord-Vietnam. Si l'on se fonde sur ces données, incontestables et cohérentes, on peut penser que les Chinois et les peuples à leur contact direct, entrèrent en relation avec l'Inde, offrant leurs épices et leur soie : nous savons que celle-ci arrivait par mer dans le Sud indien. De ce point de vue, les Indiens eux-mêmes n'auraient fait que suivre tardivement les mêmes routes, mais d'ouest en est cette fois.
"Les textes chinois sont également formels : les peuples indigènes du Sud étaient de hardis navigateurs, au point que les commerçants célestes utilisaient de préférence leurs navires. Cela implique des sociétés techniquement avancées et socialement organisées. Or l'étude de l'Âge du bronze de cette région - en gros le Ier millénaire avant J.-C. - prouve leur existence. Il est donc évident que des civilisations ou du moins des foyers fort avancés existaient dans cette région et commerçaient activement par mer. Sur le plan théorique, ce fut une erreur des premiers historiens de l'indianisation que d'avoir négligé les "récipiendaires" de celle-ci, ou de les avoir implicitement tenus pour des "primitifs". Une civilisation aussi complexe que celle de l'Inde n'a pu être assimilée puis développée que par des sociétés déjà avancées - surtout sans conquête de peuplement. Sans doute le hiatus entre historiens et philologues, d'une part, préhistoriens et archéologues, d'autre part, rend-il compte de cette faille de raisonnement."
Bernard-Philippe Groslier
"Archéologie des échanges commerciaux", article dans "Le grand Atlas de l'Archéologie", Ed. Encyclopaedia Universalis, Paris 1985, page 254.
Un témoignage de l'époque angkorienne confirme le texte de B.-P. Groslier :
"Ayant recherché en pays étranger une foule de livres philosophiques et les traités tels que le commentaire du Tattvasangraha, ce sage en répandit l'étude"
Stèle de Vat Sithor (Xè siècle), stance XXIX, traduction par G. Coedes avec l'aide d'Au Chieng, Professeur de sanscrit et de pali à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, Volume VI, Paris 1954, p. 205.
Ce texte confirme les propos de B.-P. Groslier. Ce sont les Cambodgiens de la période du Fou-Nan, puis du Chen-La (Cire pure ou Kramourn Sar), de la période angkorienne qui étaient allé aux Indes et ramener les documents de la civilisation indienne. D'ailleurs, à ce jour, il n'y a aucun document indien qui dit le contraire. De nos jours, il y a des Cambodgiens qui vont à Ceylan et en Inde pour étudier les textes bouddhiques. Il y a des bonzes cambodgiens en Inde et aucun bonze ou brahmane indien au Cambodge. Par contre il y a des témoignages sur la présence des religieux indiens en Chine, comme un certain bonze indien Boudhiama qui a séjourné à la pagode de Shao-Lin au VIè siècle et qui a inventé le Kon-Fu. De nos jours, le Kon-Fu et ses variantes comme le Karaté japonais ou le Tai-Kwan-do coréen, sont des sports très à la mode.
(5) Malleret se réfère encore probablement à G. Coedes qui, sans aucune référence attribue un sens péjoratif au mot "Yun" ou "Yuon" et le fait dériver arbitrairement au sanscrit "Yuvana". Alors comment se fait-il que les Thais aussi utilise aussi ce mot Yuon pour désigner les Vietnamiens sans connotation péjorative ? Les Chams aussi ? En réalité Yuon vient de Yué ou Yüeh ou Viet (en vietnamien le v se prononce un peut comme le y). Il est regrettable que Akashi puis certains Occidentaux proches des communistes vietnamiens nous accablent re racismes en utilisant ce mot. D'ailleurs, dans un rapport fait pas un de nos compatriotes, lors d'une réunion le 7 mars 2004, des anciens hauts responsables du régime installé par les USA au Sud Vietnam avant 1975, nous citons :
"Nous devons patienter, ne pas bouger un moment. Le Cambodge est très important pour le Vietnam à l'avenir", disait Quang Ngoc Try qui ajoutait : "Hanoi peut tuer Hun Sen à n'importe quelle heure, et Hun Sen sait qu'il est suivi nuit et jour par des agents vietnamiens. Actuellement environ deux millions de Vietnamiens [au Cambodge] sont déjà capables de vivre d'eux-mêmes. Les gens de Hanoi ont le plan suivant : sur 10 millions de Khmers, nous devons insérer au moins de 5 à 8 millions de Vietnamiens. Alors nous pourrons y faire tout ce que nous voudrons. Nous pourrons faire des manifestations contre diverses mesures, en nous appuyant sur les droits de l'homme. Nous pourrons aussi y faire la guerre pour résister car des armes y sont déjà acheminées et stockées. Nous avons des voies d'approvisionnement à partir de la frontière. Alors c'est sûr que le Cambodge ne sera pas en paix. Nous voyons nos avantages sur les Khmers sur toutes les issues."
Les Vietnamiens peuvent s'installer librement au Cambodge ". Nous pourrons faire des manifestations contre diverses mesures, en nous appuyant sur les droits de l'homme. Nous pourrons aussi y faire la guerre pour résister car des armes y sont déjà acheminées et stockées.", tout cela sous la protection des ONG qui défendent les "Droits de l'Homme". Mais il n'y a aucune ONG de ce genre pour protéger les Cambodgiens du Kampuchea Krom, ni ailleurs dans le monde. Or ces Vietnamiens viennent s'installer librement au Cambodge, y imposer leurs lois et même à nous les imposer par la force si c'est nécessaire.
En conclusion, c'est nous, de nous unir pour imposer à la communauté nationale notre vocabulaire et aussi la souveraineté de notre nation sur l'ensemble de notre territoire et de nos eux territoriales.
Khemara Jati
khemarajati@sympatico.ca
Montréal, Québec
Le 29 mars 2004
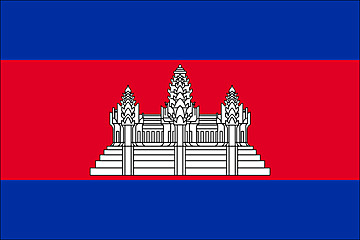

0 commentaires:
Publier un commentaire
S'abonner à Publier des commentaires [Atom]
<< Accueil